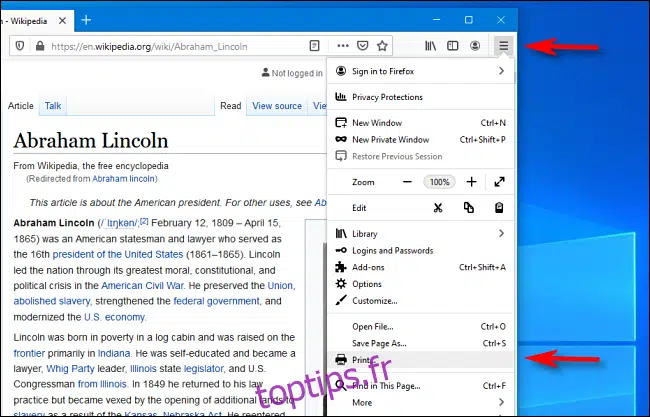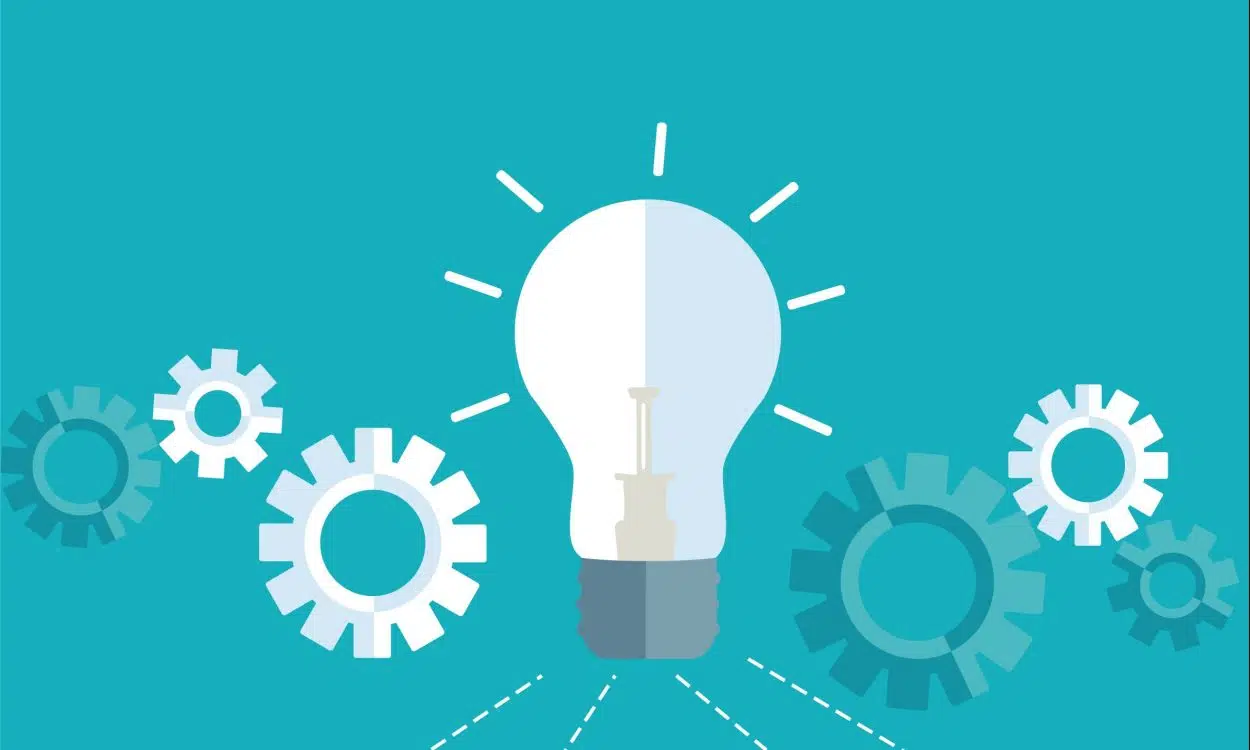12 octobre 2023. HM publie un message qui ne laisse aucune place au doute : la « solidarité indéfectible » envers Israël est martelée noir sur blanc. Pourtant, à peine quelques semaines plus tard, l’abstention lors d’un vote crucial à l’ONU brouille le signal envoyé. Entre déclarations fracassantes et prudence diplomatique, la ligne officielle oscille, sème le doute, alimente les conversations feutrées dans les chancelleries. Derrière les communiqués, une stratégie à plusieurs étages se dessine, mais rares sont ceux qui osent la détailler publiquement. L’entourage sème le flou, les partenaires scrutent la cohérence. Que cache ce jeu à géométrie variable ?
HM et Israël : comprendre les fondements d’un engagement controversé
La relation entre HM et Israël ne tombe pas du ciel. Cela fait plusieurs années que Israël accentue ses rapprochements, tout particulièrement avec certains partis d’extrême droite européens. Dans ce jeu d’influences, le Rassemblement national de Marine Le Pen ou Reconquête d’Éric Zemmour tiennent le haut du pavé. Les rencontres s’enchaînent, souvent assumées. Louis Aliot, proche de Jean-Marie Le Pen, s’est rendu à Jérusalem : un déplacement qui marque la volonté d’effacer le passé au profit d’une démarche résolument stratégique.
Tout cela n’a rien d’un rapprochement affectif. Il s’agit de trouver un intérêt commun. Pour une partie de l’extrême droite européenne, le modèle israélien s’impose : une forteresse sécuritaire, un exemple à suivre. Le discours sécuritaire, la mise en avant d’une menace incarnée par l’islam politique, servent de points de convergence. S’afficher pro-Israël offre aussi un atout pour évacuer les accusations d’antisémitisme qui collent à ces mouvements. Des analystes, tels Amir Tibon (Haaretz), examinent attentivement cette alliance entre nationalismes européens et courants conservateurs israéliens.
Quelques repères aident à comprendre comment ce mécanisme opère :
- Israël noue des liens avec des partis européens portant une histoire antisémite, le plus souvent cachée ou minimisée.
- Du côté du Rassemblement national et de ses alliés, brandir le soutien à Israël devient une porte de sortie pour gagner en respectabilité.
- Le socle du rapprochement : la désignation de l’islam politique comme ennemi central.
L’approche pragmatique prend vite le dessus. Benyamin Nétanyahou, à la tête du gouvernement israélien, multiplie les ouvertures vers des leaders européens réputés sulfureux, comme Victor Orban ou le chef de l’Alliance pour l’unité des Roumains, connu pour ses déclarations élogieuses à propos d’Ion Antonescu. Ce pragmatisme pousse à passer sous silence certains épisodes sombres de l’histoire contemporaine.
Quels sont les faits marquants qui ont alimenté la polémique autour de HM ?
La polémique HM n’est pas née d’un coup de tonnerre isolé ; elle s’est construite à coups de séquences médiatiques et de gestes qui ont fait bouger les lignes. Le 12 novembre 2023, le Rassemblement national et Reconquête défilent à Paris contre l’antisémitisme. Un choc pour nombre d’observateurs : ces mouvements, longtemps stigmatisés pour leur histoire, se retrouvent propulsés en première ligne. Voir les héritiers du Front national, fondé par un collaborateur de la Waffen SS, défiler aux côtés de figures institutionnelles bouleverse les repères traditionnels du débat public.
Les réactions ne se font pas attendre. L’opinion se divise, notamment autour de la présence de Louis Aliot, numéro 2 du FN, qui a multiplié les initiatives d’ouverture vers Israël. Beaucoup rappellent aussi que la normalisation d’accords entre Israël et certains partis européens n’a pas effacé les liens avec des personnalités comme Ion Antonescu, responsable de crimes contre les Juifs en Roumanie. Certains ramènent sur le devant de la scène les coopérations passées entre Israël et l’Afrique du Sud de l’apartheid pour souligner les calculs à l’œuvre dans certaines alliances diplomatiques.
Plusieurs faits structurent la polémique en cours :
- La relation normalisée entre l’extrême droite et la sphère politique française s’affirme un peu plus chaque jour.
- Le passé antisémite tend à s’estomper, écrasé par un discours axé sur la sécurité et le soutien à Israël.
- Dans le même temps, les relations entre la France et le Maghreb se tendent, amplifiées par la posture stricte adoptée sur l’immigration et l’islam.
Face à ces évolutions, la France avance sur une ligne de crête, prise entre des impératifs de mémoire, de stratégie politique et une crispation identitaire qui traverse une société fracturée. Pour certains, afficher le soutien à Israël sonne comme sésame pour entrer dans le cercle de la respectabilité politique.
Décryptage des réactions : entre soutien affiché et critiques virulentes
Sur la scène politique, les lignes sont tracées avec force. Les responsables du Rassemblement national comme ceux de Reconquête font de leur appui à Israël une preuve irréfutable de rupture avec l’histoire antisémite de l’extrême droite. Jordan Bardella, Marine Le Pen, Éric Zemmour clament leur solidarité en invoquant le souvenir de la Shoah et une volonté farouche d’en découdre avec l’islamisme radical.
Mais les critiques pleuvent. Beaucoup accusent ces responsables d’utiliser la lutte contre l’antisémitisme comme un levier politique et un prétexte pour stigmatiser la gauche décoloniale, tout en créant un climat de suspicion envers les musulmans. À gauche, à la France insoumise, dans le secteur associatif ou universitaire, la riposte est claire. L’idéal de laïcité, censé équilibrer le débat, se voit transformé en une « laïcité punitive » dont la cible prioritaire devient l’islam.
Loin de se limiter au théâtre national, le jeu d’alliances de Benyamin Nétanyahou continue d’interroger, à mesure qu’il ouvre la porte à des partenaires européens compromis ou sous le feu de soupçons d’antisémitisme. Les regards s’interrogent aussi sur le silence de l’Union européenne et de la France devant la tragédie humanitaire à Gaza, alors que la CPI et l’ONU sont accusées de partialité. Sur les réseaux, la tension monte : les discours antisémites, notamment sur X (ex-Twitter), ont explosé, grimpant de 60 % depuis octobre 2023.
Dans ce climat morose, la méfiance s’installe dans les quartiers populaires, majoritairement composés de citoyens musulmans. La surenchère sur l’immigration et la sécurité creuse des lignes de fracture persistantes. Parmi les défenseurs de la cause palestinienne, la dénonciation du génocide à Gaza s’impose, accusant la France d’appliquer une politique du double standard. Plus que jamais, la société se polarise, happée par le jeu de mémoires concurrentes et de stratégies partisanes.
Ce que révèle l’affaire HM sur la place des marques dans les débats géopolitiques
L’affaire HM met le projecteur sur une réalité nouvelle : la neutralité n’existe plus pour les entreprises. Prendre position sur Israël, communiquer ou s’abstenir, chaque geste compte et suscite analyse, soutien ou condamnation.
La mécanique d’alliance entre extrême droite et Israël, sur fond de stigmatisation des musulmans, finit par déborder sur l’univers des marques. Ces dernières, hier indifférentes ou en retrait, se retrouvent sommées de prendre parti. Ce phénomène dépasse largement le territoire hexagonal. En affichant une position tranchée ou en affichant un silence pesant sur le conflit israélo-palestinien, les multinationales voient leur image bousculée sur d’autres marchés. En particulier dans le Maghreb, le soupçon d’alignement sur Israël accentue les crispations, tandis que la polarisation française rejaillit sur leurs stratégies de communication jusque dans le moindre slogan.
Les entreprises voient s’accumuler diverses difficultés, à la hauteur de la pression publique et médiatique :
- Atteinte à la réputation, multiplication des appels au boycott et critiques massives
- Pressions opposées de la part des actionnaires, des mouvements sociaux et des consommateurs, tous en attente de gestes forts ou d’un engagement assumé
- Impossibilité pour un groupe au rayonnement international de prôner une ligne cohérente sur des marchés aux attentes contradictoires
Le terrain économique est devenu le prolongement du champ politique. Chaque marque avance désormais à découvert, à la merci d’un retournement ou d’une campagne hostile. Ce qui était voie de prudence hier passe désormais pour de la compromission, voire de la lâcheté.
Plus personne ne franchit cette tempête sans s’exposer. La nouvelle question est limpide : jusqu’où chaque acteur, entreprise ou parti, acceptera-t-il d’aller pour défendre sa propre version du réel ?